XVIIe-XVIIIe siècles
-

Donner la parole aux images, les animer : tel semble bien être l'enjeu majeur de la «rhétorique des peintures» qui trouve à s'exprimer dans la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle. Le corps de l'image réclame une âme, comme ne cessent de le répéter les préfaces aux livres illustrés depuis le XVIe siècle, constatant ainsi la nécessité d'un composé scripto-visuel au cœur de toute économie symbolique. Ralph Dekoninck s'attache, dans un premier temps, à définir cette dernière au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la culture visuelle jésuite, largement tributaire de l'anthropologie chrétienne médiévale et de ses remaniements modernes. Le principe de la ressemblance en acte et de l'imitation existentielle que supposent la «théologie du visible» et la «philosophie de l'image» des membres de la Société de Jésus a nourri une riche iconologie, fondée sur l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire sur le principe d'un Logos fait image, induisant à son tour l'idéal du «tableau vivant» ou de la «peinture parlante». Sur la base d'une analyse des livres de spiritualité illustrés à Anvers entre 1585 et 1640, la seconde partie de l'ouvrage examine comment la production visuelle jésuite rejoue la dynamique christologque de l'avènement de la vérité à la visibilité et la dialectique anthropologique de la poursuite de la ressemblance dans la dissemblance, ce double mouvement qui présume que le sens n'est jamais donné d'emblée, mais reste toujours à conquérir.
-
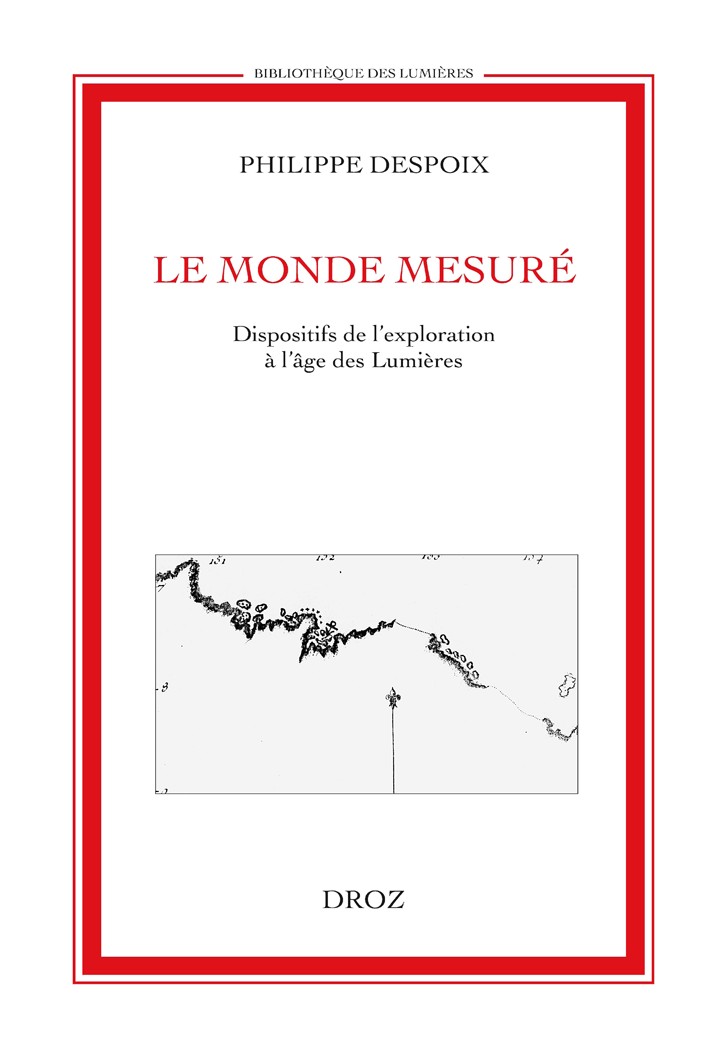
"Le Monde mesuré" rend compte des pratiques d'exploration à l'âge des Lumières, en particulier des programmes européens de circumnavigation des années 1770-80, et, partant, analyse le discours qui s'y appliqua. Pour le déchiffer, Philippe Despoix examine les a priori scientifiques de la technique d'orientation géographique de ces entreprises qui parachèvent alors la carte du monde; la répercussion que donnent à ces dernières les relations imprimées et richement illustrées circulant en Europe; les déplacements sémantiques, avec l'usage naissant de termes tels qu'«indigène», «civilisation» ou «Européen», que ces pratiques induisent; finalement il étudie les représentations esthétiques et littéraires dont elles sont l'objet. Tout un ensemble de figures nouvelles s'en dégage en effet : l'artisan horloger et ses chronomètres marins faisant concurrence au pouvoir de l'astronome royal; le voyageur auteur de sa relation qui, tel Bougainville, Cook ou Forster, détrône l'ancien compilateur; l'indigène des mers du Sud, introduit comme sujet anthropologique; mais également le public européen auquel ce discours de la découverte s'adresse désormais plus qu'aux monarques ou aux savants. L'approche comparée enseigne que les différentes représentations - scientifiques, médiatiques, fictionnelles - liées à ces pratiques exploratoires se répondent et allient les termes du savoir et du pouvoir pour défaire ceux de la souveraineté traditionnelle.
Philippe Despoix possède une double formation scientifique et philosophique. Il enseigne la littérature comparée à l'Université de Montréal et y dirige le Centre canadien d'études allemandes et européennes. Auteur de plusieurs ouvrages sur la modernité allemande, il a également coédité Crosscultural Encounters and Constructions of Knowledge in the 18th and 19th Century (2004). Ses recherches actuelles portent sur la fonction des médias dans les processus de transferts culturels.
-
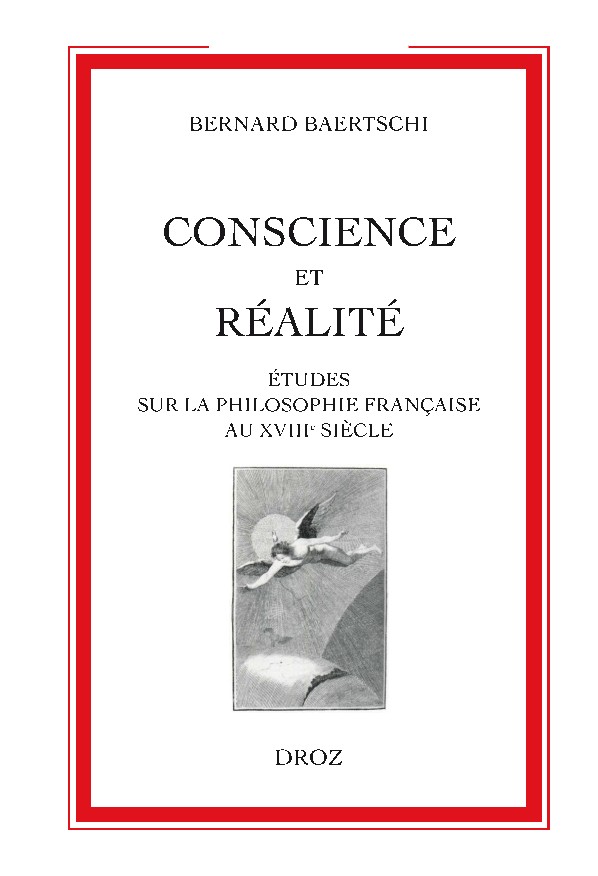
Les philosophes du XVIIIe siècle se placent sous une double bannière : celle de Descartes et celle de Locke. C'est dire que, pour eux, l'épistémologie est devenue la discipline philosophique fondamentale, qu'elle a détrôné la métaphysique identifiée avec la scolastique. D'où cette thèse, que l'on rencontre partout, que nous ne connaissons que nos idées, voire que seules nos idées existent. Comment la comprendre : signifie-t-elle, à la manière de Locke, que nous ne connaissons pas la nature des choses ou implique-t-elle, dans un style plus cartésien, un scepticisme sur l'existence du monde extérieur, voir un idéalisme ?
Que savons-nous de la réalité extérieure et comment l'appréhendons-nous ? Mais aussi : que savons-nous de nous-mêmes et comment nous connaissons-nous ? Telles sont les questions qu'examine Bernard Baertschi dans Conscience et réalité, un recueil d'études qui, le XVIIIe siècle philosophique prenant véritablement fin, en France, au début du XIXe siècle, courent de Condillac jusqu'à Maine de Biran et aux Idéologues.
-

Lorsque Buffon mourut en 1788, on rappela sa vie en deux biographies élogieuses. Disparus dix ans plus tôt, Rousseau et Voltaire étaient toujours bien vivants dans la mémoire générale. Sur Rousseau, il y eut les éloges de Bilhon et de Desmolin et, surtout, la Lettre de Madame de Staël. Voltaire fut l'objet de la critique de Gibert, de Ruault et de Linguet, en particulier. Avec Linguet, les écrivains les plus en vue étaient Condorcet et Mirabeau.
Les traductions en langue française étaient nombreuses, notamment de l'anglais et de l'allemand. La popularité du roman anglais ne montra aucun signe de recul.
La religion restait une préoccupation majeure. La publication de recueils de sermons et d'ouvrages d'instruction et d'édification répondait aux vœux des fidèles. Les protestants jouissaient alors de l'égalité civile et d'une large mesure de liberté de culte. Cette nouvelle politique, hautement controversée, fut officiellement opposée par l'Eglise.
Pour réformer le système de justice et limiter le rôle politique des parlements, le roi décida de créer une nouvelle institution, appelée la Cour plénière, dont l'administration fut confiée à Lamoignon, garde des sceaux. Ce projet suscita une violente opposition, même des émeutes, comme à Rennes et à Grenoble. Alors, pour gagner le soutien général, le roi annonça sa décision de convoquer les Etats généraux en 1789, plutôt qu'en 1792 comme il avait annoncé. Le projet d'établir la Cour plénière fut abandonné.
-

On sait ce qu'il en est de la transparence du discours, et la parole semble souvent masquer plutôt que produire ou révéler son objet. Ce volume tente d'explorer principalement l'inscription de ces pratiques retorses dans les genres littéraires aux XVIe et XVIIe siècles. Certes, les textes à clé et les déguisements d'auteur posent de manière éclatante la question de la mystification littéraire. Mais même dans les écritures revendiquant la vérité - essai, histoire, satire -, le travail de la citation, les jeux énonciatifs brouillent le genre d'origine et utilisent le détour pour accéder au vrai. Dans les genres de la fiction, le théâtre décline tous les artifices d'une représentation et d'une énonciation complexes : corps à interpréter, comédien transformé par son rôle, scènes à visées multiples, discours protéiformes - secrets, surpris, équivoques, artificieux - où s'estompent les différences entre tragédie et comédie, où émerge l'anthropologie sous-jacente. Mais c'est sans doute l'écriture romanesque qui mène le plus loin ces jeux du mensonge et de la vérité. Le titre, la traduction, les registres et les tons, les voix inscrites dans le roman, les jeux avec l'institution littéraire construisent non seulement l'©nigme de l'histoire et des personnages, mais celle de l'auteur, de ses visées et plus généralement de la signification de l'œuvre, selon un « esprit de complexité » qui définit la modernité du roman. Par l'exhibition des artifices de la littérture, c'est au déchiffrement que nous sommes invités : dans l'œuvre spirituelle où les figures sont accès à la transcendance, mais aussi dans l'œuvre de fiction où le lecteur diligent doit élucider les signes. Le plaisir du texte et la recherche du sens sont ici inséparables : la parole masquée, au cœur de toute œuvre littéraire, s'avère, paradoxalement, un puissant révélateur.
-

Sommaire: P. Bourgain, «Réflexions médiévales sur les langues de savoir»; A. Grondeux, «Le latin et les autres langues au Moyen Age: contacts avec des locuteurs étrangers, bilinguisme, interprétation et traduction (800-1200)»; P. Lardet, «Langues de savoir et savoirs de la langue: la refondation du latin dans le De causis linguae latinae de Jules-César Scaliger (1540)»; J.-M. Mandosio, «Encyclopédies en latin et encyclopédies en langue vulgaire (XIIIe-XVIIIe siècles)»; C. Lecointre, «Lappropriation du latin, langue du savoir et savoir sur la langue»; M. Furno, «De l’érudit au pédagogue: prosopographie des auteurs de dictionnaires latins, XVIe-XVIIIe siècles»; B. Colombat, «Changement d’objectif et/ou changement de méthodedans l’apprentissage du latin au XVIIe siècle? La Nouvelle Méthode […] latine de Port-Royal»; M. Bouquet, «Le De viris illustribus de Lhomond: un monument de frantin»; J. Royé, «La littérature comique et la critique du latin au XVIIe siècle»; M. Lemoine, «Les néologismes dans le commentaire de Calcidius sur le Timée»; J. Ducos, «Passions de l’air, impressions ou météores: l’élaboration médiévale d’un lexique scientifique de la météorologie»; J. Paviot, «Le latin comme langue technique: l’exemple des termes concernant le navire»; M.-J. Louison-Lassablière, «Antonius Arena ou le latin macaronique au service du savoir chorégraphique»; L. Boulègue, «Le latin, langue de la philosophie dans les traités d’amour du XVIe siècle en Italie. Les enjeux du De Pulchro et Amore d’Agostino Nifo»; G. Demerson, «Langue ancienne et nouveau Monde»;
A. Vanautgaerden, «L’œuvre ‘latin’ de Jean Froben, imprimeur d’Erasme»; J.-F. Cottier, «Les Paraphrases sur les Evangiles d’Erasme: le latin, instrument de vulgarisation des écritures?»; D. de Courcelles, «Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), traducteur du grec et historiographe en langue latine: sur le choix de l’écriture en langue latine en Espagne vers 1540»; H. Cazes, «La Dissection des parties du corps humain et son double: les anatomies latine et française de Charles Estienne (Paris, 1545-1546)»; E. Wolff, «Jérôme Cardan (1501-1576) et le latin»; L. Goupillaud, «Demonstrationem mirabilem sane detexi: mathématiques et merveille dans l’œuvre de Pierre de Fermat»; J. Schmutz, «Le latin est-il philosophiquement malade? Le projet de réforme du Leptotatos de Juan Caramuel Lobkowitz (1681)»; Y. Haskell, «Bad taste in baroque Latin? Father Strozzi’s Poem on Chocolate»; A. Michel, «Le latin, les mots et les choses: Virgile, Eckhart, Edmond Jabès».
-
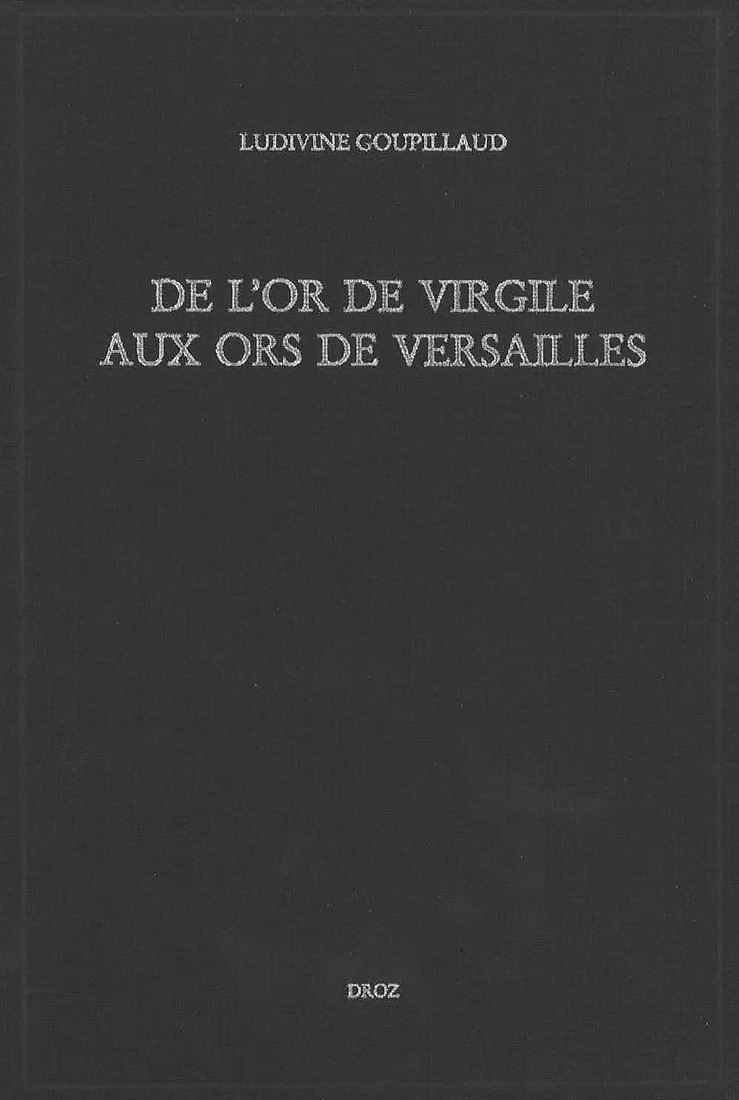
Partant du principe qu'il n'existe pas d'écriture orpheline au XVIIe siècle, Ludivine Goupillaud apprécie la filiation unissant les hommes du siècle de Louis XIV à l'auteur de l'Enéide. Ainsi examine-t-elle successivement le cas des « héritiers » - qui revendiquent ouvertement le patrimoine virgilien -, celui des « fils prodigues » - qui s'en réclament, tout en cherchant de nouveaux modèles appropriés à leur temps -, celui, enfin, des « affranchis » - qui contestent ouvertement la suprématie poétique du Cygne de Mantoue et briguent une totale autonomie par rapport aux auctoritates antiques. La richesse des opinions résiste à une explication sommaire que l'on poursuivrait vainement dans la dichotomie habituelle entre « Anciens » et « Modernes ». Il s'agit plutôt de montrer, analyses textuelles à l'appui, que l'Enéide est la source vive à laquelle puisèrent, avec des présupposés et des ambitions différents, voire divergents, tous les hommes qui, au XVIIe siècle, faisaient �rofession d'écrire ou, plus largement, de créer. En effet, le rôle formateur de l'épopée virgilienne se manifeste également dans d'autres domaines artistiques, comme la peinture ou l'architecture. De là cette analogie, si souvent rencontrée dans les textes contemporains, entre l'épopée et un grand palais ; c'est Versailles en effet qui parvient à matérialiser, mieux que ne l'eût fait le récit des exploits de Louis le Grand, l'apogée « héroïque » d'une culture et d'une sensibilité originales.
-

L'étonnement ne tarit pas à la découverte de la Novissima Linguarum Methodus que l'intellectuel morave Jan Amos Komensky, mieux connu sous le nom de Coménius, publie en 1648 dans laquelle il expose et justifie sa méthode d'enseignement et d'apprentissage des langues. Ce traité possède à peu près toutes les caractéristiques d'un manuel du XXe siècle et fait incontestablement de son auteur l'initiateur de la pédagogie moderne. Sa conception du langage, des langues véhiculaires et vernaculaires, sa définition des relations entre la langue et la réalité individuelle, sociale et culturelle de ceux qui la pratiquent, de même que ses conceptions pédagogiques, autrement dit l'accointance qu'il établit entre une instruction universelle et la perfectibilité humaine, sont en avance de trois siècles sur les opinions ethnolinguistiques et didactiques de l'époque. A la lecture de La toute nouvelle méthode des langues, traduite en français pour la première fois, il est permis de se demander si l'approche de Coménius ne serait pas le chaînon manquant entre les grandes interrogations de Platon et de Saint Augustin sur des sujets du même ordre et celles de savants contemporains comme De Saussure, Bloomfield, Martinet et Piaget.
A l'heure où la communauté francophone s'interroge de par le monde sur ce qu'il est convenu d'appeler l'exception culturelle, la réflexion de Coménius contient de précieuses analyses et abonde en pistes comme en solutions.
-

On croit bien connaître le divin marquis. Depuis deux siècles, la critique littéraire s’est bâtie sur une conviction profonde, persistante et consensuelle: l’immoralisme de Sade qui, dit-on, fait l’apologie du crime, du vice, du mal. On s’occupe de nous dire comment, on ne demande pas pourquoi. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer établit qu’il s’agit là de l’un des plus formidables contresens de l’histoire des idées. Dans quelle mesure Sade pense-t-il ce qu’il écrit? Selon une méthode rigoureuse, fondée essentiellement sur la contextualisation de l’œuvre, sont dégagées de frappantes coïncidences entre le monde sadien et la réforme pénale française du XVIIIe siècle. A travers l’environnement judiciaire d’un écrivain emprisonné se dévoile, contre toute attente, un Sade moraliste que conforte l’argumentation philosophique, juridique comme historique. En travaillant sur la totalité des textes du marquis, de la fiction à la correspondance et des ouvrages les plus fameux aux lignes habituellement négligées, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer montre pourquoi le moralisme de Sade unifie son œuvre, tandis qu’on ne pouvait jusqu’alors rendre compte de son prétendu immoralisme qu’en la divisant.
-
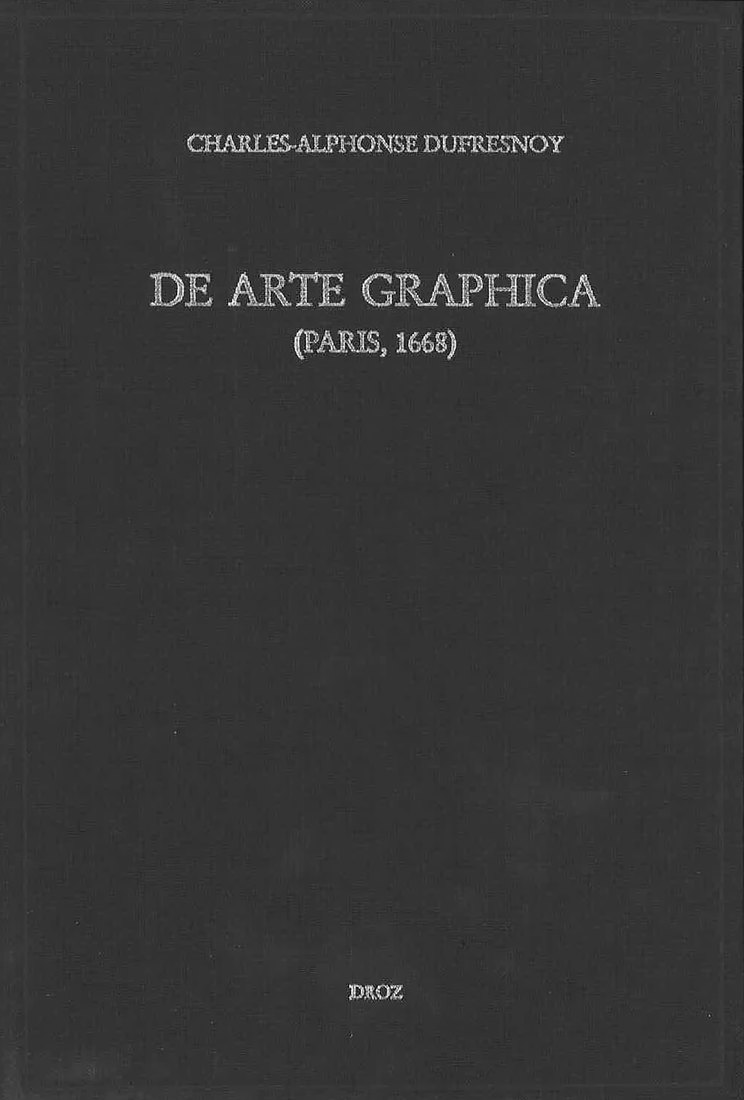
De arte graphica, poème didactique en latin sur l’art de la peinture, fut commencé par Charles-Alphonse Dufresnoy à Rome vers le milieu des années 1630 et vit enfin le jour à Paris en 1668, quelques mois après la mort de l’auteur. Cette première édition, accompagnée d’une traduction et d’un commentaire par Roger de Piles, connut un succès considérable. Elle devint bientôt un classique moderne et une référence indispensable pour les académies d’art fondées partout en Europe au XVIIIe siècle, ce qui ne va pas sans une certaine ironie quand on pense aux relations difficiles entre Dufresnoy et surtout Roger de Piles et l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, modèle de toutes les autres. Le poème de Dufresnoy connut ainsi de multiples éditions et traductions au cours du siècle et demi qui suivit sa première parution, avant de tomber dans l’obscurité avec le triomphe du romantisme et de l’art moderne.
Pour le lecteur contemporain, De arte graphica représente surtout une distillation des deux premiers siècles de la théorie moderne de la peinture – d’Alberti et Léonard de Vinci à Dolce, Lomazzo, Vasari, Armenini et, enfin, à Agucchi et à l’ami de Dufresnoy Giovanni Pietro Bellori. Les 549 vers de son poème latin, avec les essais préliminaires et le commentaire détaillé qui constituent la présente édition, forment ainsi une véritable introduction aux principaux thèmes de la théorie moderne de la peinture.